Difficile de passer à côté de la nouvelle série Canal, annoncée en grande pompe et saluée par les critiques comme les téléspectateurs. A les lire, on frôlerait le chef-d’œuvre. David Fincher aux commandes, Kevin Spacey au charbon ; un portrait sans concession d’une société du pouvoir. Ici, on ne vise pas le grand public, mais le CSP+ averti. Du moins, c’est comme ça qu’on nous avait (sur)vendu la bête.
Les deux premiers épisodes de la série ont été réalisés par David Fincher et c’est rien de le dire. Couleurs froides, silences éloquents, plans réfléchis ; chaque scène est un tableau. Le spectateur se pourlèche les babines, pressentant du grand spectacle. Nous entrons dans la valse des petits fours et des campagnes électorales avec un bien mauvais compagnon mais le meilleur des guides : Francis Underwood.
Tel Richard III dans la pièce éponyme, il prend littéralement le spectateur en aparté, lui dévoilant avec sarcasme les intrigues politiques et les vrais visages de ses interlocuteurs. Franck a été blessé dans son orgueil. Il ourdit désormais une terrible vengeance visant à l’humiliation du gouvernement. Dès le début, on la savoure, cette revanche, on la fait nôtre : le crime ne restera pas impuni. Vas-y, Franckie ! Montre-leur de quel bois tu te chauffes à ces gougnafiers démocrates !
D’ailleurs, c’est là, entre autres, que le bât blesse. Quoiqu’on ne puisse deviner à l’avance les stratagèmes qui permettront à Underwood d’emporter la partie, nous savons d’avance qu’il l’emportera. Pas au paradis, certes. La plupart des épisodes sont construits sur le même schéma : Franck est mis en danger, tangue sur le fil du rasoir, mais peaufine une idée salvatrice depuis au moins le premier tiers de l’épisode, tout en faisant semblant d’avoir peur. C’est le syndrome Suits. Si certains coups durs nous font froid dans le dos – peut-on vraiment se relever d’un remix techno de notre plus lamentable intervention télévisée ?, la menace ne nous effraie parfois même pas (cf. le péchoïde) et, dès le cinquième épisode, on fait une croix sur le suspense.
Pour accomplir son grand œuvre, Franck est épaulé par sa femme, qui, malgré son air de ne pas y toucher, est de toutes les magouilles ou presque. Dans cette série, les femmes ont cette particularité d’avoir du caractère. D’habitude, on compte une Anna Wintour par production ; dans House of card, il suffit de se baisser. Dans la course au cynisme, et quoique l’ambitieuse Zoe Barnes tire son épingle du jeu, c’est l’énigmatique Robin Wright qui tient le haut du pavé. La moitié de Franck Underwood fait ce que toutes les épouses de politicien font : elle s’adonne à la charité, gracieusement, le port altier et le verbe mesuré. Mais elle est aussi à même de briser les carrières de ses protégés ou encore les idéaux d’un bonhomme d’un coup de main.

Avec House of cards, on est clairement du côté des vilains. Cela dit, il n’y a pas exactement d’alternatives : si les héros sont scélérats, leurs ennemis le sont tout autant. Pour le coup, les desperate congressmen sont vraiment « tous pourris ». Ils ne sont pas acculés par leur impuissance face à la gabegie ambiante, mais juste mus par une inextinguible soif d’argent, de pouvoir ou de plaisir qui les rend inaptes à toute recherche du bien commun. Mais ce ne sont pas les prostituées, la cocaïne et les dessous de table qui rendent une histoire réaliste et des personnages attachants. C’est la précision, la subtilité, les petits riens, presque indicibles, qui font qu’un protagoniste sonne vrai. Or, si les personnages de House of cards ne sont pas des caricatures, ils ne sont ni subtils ni attachants.
A ce titre, l’ex bras droit de Carcetti, qui incarne désormais Freddy, le noir-toujours-content-parce-que-l’argent-ne-fait-pas-le-bonheur et dont le gimmick principal est de reprocher à Franck sa générosité, fait peine à voir dans son boui-boui. Lui qui conseillait le maire de Baltimore avec des piques bien senties, vend aujourd’hui sa sagesse populaire sous forme de côte de porcs bien grasses que Franck Underwood s’enfile dès le matin, loin des chimères de DC, parce qu’au fond, vanitas vanitatum, il n’y a que ça de vrai dans la vie.
A Washington, et aux Etats-Unis en général, il n’y a pas que des hommes riches et puissants, il y a aussi le petit peuple, le menu fretin. Alors, on ne s’appesantira pas sur le clochard qui crache sur des billets de vingt dollars et on ne niera pas qu’il existe d’humbles vendeurs de ribs qui se plaignent de ce qu’on les paie trop. Leur travail est honnête et, par voie de conséquence, ne mérite qu’un maigre salaire. En revanche, on reste troublé par cette grève d’enseignants brisée par le don des côtes de porc susmentionnées.
Morales de l’histoire :
- Le riche veut de l’argent ou du pouvoir. A noter que vouloir de l’argent fait « nouveau riche » (ancien pauvre ?) et donc mauvais genre.
- Le pauvre se décline en deux modèles : il y a le bon pauvre qui se contenterait d’un rien du moment qu’il peut philosopher à son aise en regardant frire ses côtes de porc ; le mauvais pauvre qui gueule pour rien mais qui veut bien la fermer à condition qu’on lui remplisse la panse desdites côtes de porc.
- Les femmes sont des hommes en plus jolies.



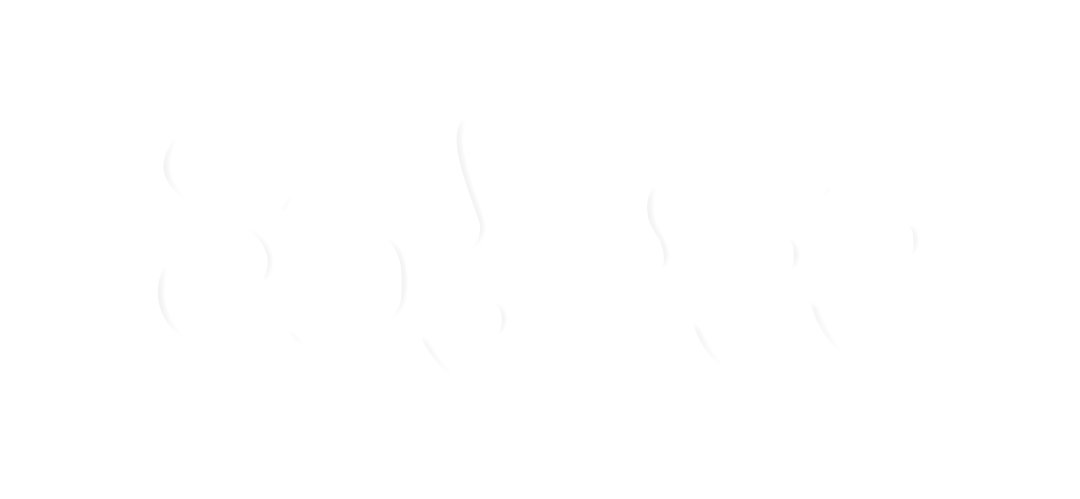
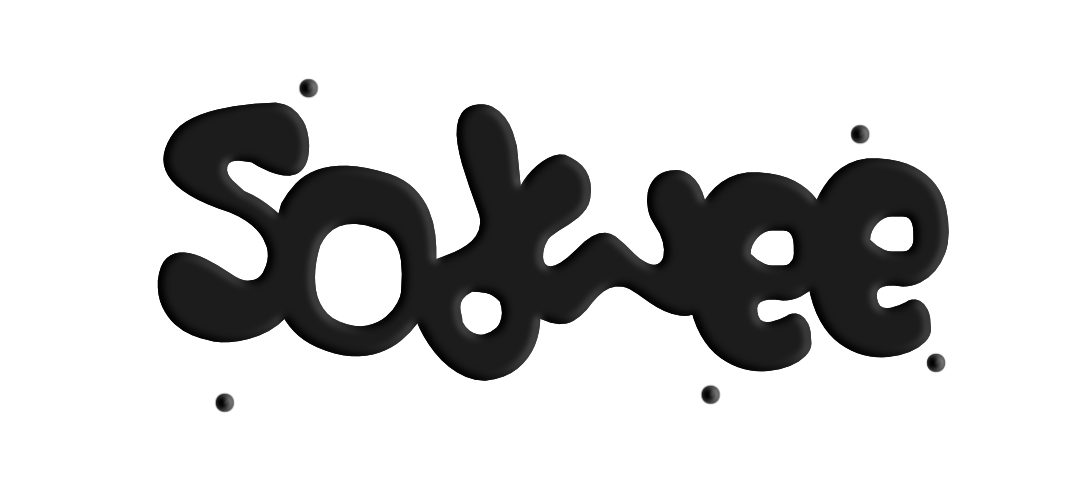










Quelqu’un a vu la nouvelle saison de Dallas, où l’univers était lui aussi impénétra-able ? Car JR (mais aussi la Naine et l’ancien homme-poisson) n’était ni subtil, ni attachant, et vraiment caricatural, mais c’est un “méchant” qu’on a aimé détester il y a 20-25-30 ans (rayer la mention inutile).
A cette époque, on avait moins d’attentes. Avec dix séries à tout casser, on allait pas en plus réclamer de la qualité.
C’est surtout qu’avant, et bennnn y’avait pas internet. HEH!